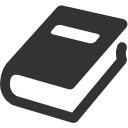Sources : les données mobilisées sont principalement issues des déclarations sociales nominatives (DSN).
Toutes les heures supplémentaires effectuées n’ont pas donner lieu à compensation.
⇒ L’évolution de la pratique des heures supplémentaires.
Le nombre moyen d’heures supplémentaires rémunérées par salarié à temps complet dans le secteur privé évolue relativement peu entre début 2013 et début 2018 ; Il progresse nettement fin 2018 et début 2019 (+13,3%), une hausse coïncidant avec l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2018 qui exonère les heures supplémentaires de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu. La crise sanitaire se traduit ensuite par une forte diminution des heures supplémentaires rémunérées (-22,8% au 2e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent). Mais, depuis l’été 2021, leur nombre repart à la hausse. En 2023, il est supérieur de près de 20% à celui observé 10 ans auparavant.
⇒ Qui en bénéficie ?
– 60% de hommes effectuent au moins une heure supplémentaire rémunérée, contre 44% des femmes quel que soit leur âge. Les hommes en accomplissent davantage que les femmes (117, contre 79 heures).
– Les salariés les plus jeunes, tout comme les plus âgés, sont moins coutumiers du fait, respectivement 50% et 44% d’entre eux en effectuant.
– Les ouvriers sont les plus nombreux : 69% vs 50% des employés, 46% des professions intermédiaires et 38% des cadres.
– Les salariés réalisant des heures supplémentaires rémunérées perçoivent en contrepartie 1 906€ brut en moyenne en 2023. Les femmes, les employés et les jeunes de moins de 30 ans reçoivent pour leurs heures supplémentaires une rémunération de 1 042 à 1 425€ brut, alors que les cadres reçoivent 3 151€ brut.
– Le recours aux heures supplémentaires rémunérées est plus répandu au sein des entreprises de moins de 50 salariés : 60% contre 50 dans les entreprises de 500 salariés ou plus. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les personnes effectuant des heures supplémentaires en font environ 130 en moyenne dans l’année, soit deux fois plus que dans les entreprises de 500 salariés ou plus (64).
Plus généralement, le nombre d’ֽheures supplémentaires rémunérées par salarié en effectuant a tendance à décroître à mesure que la taille de l’entreprise augmente.
⇒ Mais tous ne bénéficient pas d’heures rémunérées, notamment lorsque leur contrat prévoie qu’elles y soient intégrées, c’est le cas des cadres et des salariés des plus petites entreprises.
En fait 19%, dans la mesure où moins d’un cadre sur deux est soumis à ce régime horaire ; mais en réalité, ils réalisent un volume plus important que les autres salariés (121 heures, contre 117 pour les ouvriers, 95 pour les professions intermédiaires et 87 pour les employés).
10% des cadres effectuant le plus d’heures supplémentaires rémunérées en réalisent 208 ou plus dans l’année, un niveau toutefois comparable à celui des employés (208) et des professions intermédiaires (210), mais nettement inférieur aux ouvriers.
C’est aussi le fait des petites entreprises qui conservent plus souvent que les autres une durée hebdomadaire collective de travail supérieure à la durée légale, c’est-à-dire inscrites dans le contrat de travail. De fait, dans ces entreprises, les heures supplémentaires structurelles, c’est-à-dire inscrites dans le contrat de travail, sont majoritaires.
⇒ En 2023, les salariés à temps partiel ne sont en effet que 34% à effectuer au moins une heure complémentaire rémunérée dans l’année, soit 1,6 million de personnes.
Ils effectuent en moyenne 33 heures dans l’année (3 fois moins que pour les salariés à temps complet), pour une rémunération de 603€ brut. Les femmes, les jeunes et les employés y travaillent plus souvent à temps partiel. Ces heures complémentaires sont plus souvent réalisées dans les entreprises de grande taille : 44% des salariés à temps partiel des entreprises de 500 salariés ou plus effectuent au moins une heure complémentaire rémunérée dans l’année, contre 20% de ceux des entreprises de moins de 10 salariés. Les HCR sont l’un des secteurs y ayant le plus recours et également l’un de ceux où la pratique des heures complémentaires rémunérées est la plus fréquente (45% des salariés à temps partiel concernés), avec le secteur du commerce et de la réparation d’automobiles, alors que dans la construction, seuls 14% y effectuent des heures complémentaires rémunérées ; toutefois, lorsque ces salariés réalisent des heures complémentaires rémunérées, ils en effectuent toutefois plus que la moyenne (41 heures dans l’année, contre 33).
⇒ Mais près de 3 salariés sur 10 déclarant faire des heures supplémentaires ne bénéficient d’aucune compensation, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.
27% des salariés à temps complet (hors forfait-jours) qui effectuent des heures supplémentaires déclarent ne pas percevoir de rémunération ni bénéficier d’un repos en compensation.
Cette part est un peu plus élevée pour les femmes (30%) que pour les hommes (25%), pour les 60 ans et plus (32%) vs 21 pour les moins de 30 ans, pour les professions intermédiaires (28%) et peu parmi les employés (19%) et les ouvriers (11%), mai beaucoup plus chez les cadres (58%).
⇒ Heures supplémentaires aléatoires ou occasionnelles et heures supplémentaires structurelles.
Dans les plus grandes entreprises, les heures supplémentaires rémunérées sont en majorité destinées à faire face à un surcroît temporaire d’activité : c’est le cas pour 55% des heures supplémentaires rémunérées dans les entreprises de 250 à 499 salariés et 59% dans celles de 500 salariés ou plus.
À l’inverse, dans les entreprises de moins de 100 salariés, la durée collective hebdomadaire de travail demeurant plus fréquemment supérieure aux 35 heures légales, les salariés font mécaniquement plus souvent des heures supplémentaires, pré vues dans leur contrat de travail : on parle d’heures supplémentaires « structurelles ». Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les 2/3 des heures supplémentaires rémunérées sont structurelles, vs 1/3.
Les entreprises de 100 à 249 salariés recourent autant aux heures supplémentaires aléatoires qu’aux heures supplémentaires structurelles.
Dans les secteurs des activités immobilières et de l’informatique-communication, les parts d’heures supplémentaires structurelles sont les plus élevées (respectivement 80 et 84%) ou encore au sein des HCR (76%). Alors qu’elles sont plus souvent aléatoires dans le secteur des industries de l’énergie, l’eau, la gestion des déchets (76%) et dans l’enseignement, la santé et l’action sociale privés (77%).
Pour en savoir davantage : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-heures-supplementaires-remunerees-quels-salaries-quelles-entreprises