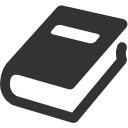Il est proposé d’organiser la RTE autour de quatre grands thèmes.
La notion de « territoire » : “le concept de territoire est une notion polysémique, ancré dans des échelles et espaces divers, renvoyant tour à tour à la commune, au bassin de vie, à la région… Il s’inscrit à la croisée des sciences humaines et sociales (sociologie, sciences politiques, économie…), mais aussi dans les champs de l’écologie, de l’agriculture, de la santé et bien d’autres encore ; d’autres relie le territoire à l’espace vécu, d’autres encore à sa dimension collective et sociale, comme un ensemble dans lequel des personnes partagent des représentations et des actions. Enfin, le territoire se définit par rapport à ses limites, qu’elles soient naturelles, juridiques, administratives, culturelles, biologiques ou sociales ; il implique une forme d’appropriation par l’homme”.
En déterminant l’échelle territoriale adaptée à ses enjeux, une entreprise transforme son espace d’implantation en levier de compétitivité stratégique et peut s’intégrer dans une dynamique vertueuse avec les parties prenantes locales.
Le développement de la RSE a progressivement attiré les enjeux économiques sur le champ de la morale .Cet engagement se mesure par un instrument, contribuant à la structuration du réel, porteur d’un système de valeurs et de normes, une norme qui s’adresse à l’ensemble des entreprises, quels que soient leurs statuts.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié en novembre 2010 la norme ISO 26000 pour aboutir à un consensus international, précisant le périmètre de la RSE autour de 6 grands axes : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le développement local.
L’enjeu pour les entreprises est donc de continuer à générer de la valeur tout en respectant ces nouvelles directives.
À contre-courant d’une mondialisation débridée, la notion de responsabilité territoriale des entreprises (RTE), vise à souligner le rôle majeur des entreprises sur leur territoire d’implantation et à mettre en lumière les externalités positives et négatives qui en découlent.
L’intuition fondamentale est de créer du commun entre les acteurs qui occupent un même territoire. Ou, plus précisément, créer du commun à partir du territoire.
Il est proposé d’organiser la RTE autour de quatre grands thèmes :
– Une cartographie de l’implantation géographique : nombre d’emplois directs, en CDI et en CDD, nombre d’emplois indirects (services, etc.), sous-traitants, achats dans le territoire concerné,
– Les moyens de déconcentration des lieux de travail : pourcentage de salariés en télétravail et investissements dans ces espaces,
– Les facilités de mobilité : aide à la recherche d’emploi du conjoint, aide à la mobilité quotidienne des salariés et aide aux déménagements,
– L’implication dans le tissu économique et éducatif local : investissement dans des formations diplômantes, investissement dans la formation professionnelle, nombre d’alternants issus d’établissements du même territoire et nombre de mécénats de compétence.
La prise en considération de la RTE montre de manière concrète comment les entreprises font vivre leur environnement, notamment en matière d’emplois ou d’investissements.
Les Français et la responsabilité territoriale des entreprises (enquête Harris Interactive et Taluna, publiée en septembre 2022 par ESS France).
Pour 96% des répondants, une entreprise se doit d’avoir une responsabilité territoriale et pour 64% cela est même essentiel. Si les Français croient au rôle vertueux des entreprises dans leur territoire d’implantation, notamment les PME-PMI, leur confiance est mitigée envers les grandes entreprises et le système économique du pays.
Pour 89% des personnes interrogées, une entreprise qui s’engage en faveur du territoire dans laquelle elle est implantée lui permet de se différencier de ses concurrents (en termes d’image, de crédibilité…).
Autre constat : plus sa taille de l’entreprise est réduite, plus la perception de sa responsabilité territoriale est élevée : les 3/4 des Français déclarent ainsi que les PME et les TPE font preuve de responsabilité à l’égard des territoires sur lesquels elles sont implantées, contre moins de la moitié en ce qui concerne les multinationales.
Pour favoriser l’implantation pérenne des entreprises et le caractère vertueux de ses interactions avec les autres acteurs locaux, il s’agit de développer des stratégies d’ancrage territorial. Le rôle des acteurs publics locaux prend toute son importance pour entretenir, développer et animer ces réseaux et favoriser les effets d’entraînement.
5 propositions :
1. Au niveau européen : préserver la compétitivité des entreprises et permettre une préférence locale,
2. Au niveau national : faire de la production locale une priorité nationale. Entre 2000 et 2022, la part de l’industrie dans le PIB national est passée de 14,5 à 9,5%, tandis qu’en Allemagne, cette proportion ne diminuait que de 20,5 à 18,4%. Dans le même temps, le solde commercial français, qui présentait un excédent de 20Md€, s’est effondré, jusqu’à atteindre un déficit record de 164Md€
3. Au niveau des collectivités locales : créer un référentiel pour mesurer le rayonnement territorial des entreprises,
4. Au sein des entreprises : partager les bonnes pratiques et développer des certifications. Les entreprises peuvent repenser leurs collaborations, par exemple au niveau des associations de filière. Les clubs d’entreprise et les chambres de commerce et de métiers, à l’échelle offrent des cercles pertinents pour décrypter ces évolutions et animer ces dispositifs.
5. Du côté des consommateurs : donner du sens à leurs achats pour valoriser les acteurs locaux
Pour en savoir davantage : https://institut-terram.org/wp-content/uploads/2025/02/IT_ETUDE-00010_AUTHIER-LYONNET_2025-02-27_w.pdf