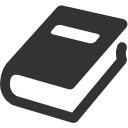La recherche s’est penchée sur l’introduction dans le cursus de formation des alternants d’espaces dits « intermédiaires », dont la vocation est d’aider les jeunes à articuler connaissances théoriques et savoirs d’action et d’œuvrer ainsi à un modèle pédagogique plus intégré de l’alternance.
Les conditions pour qu’émerge un savoir faire au sein d’un métier.
♦ Ce que sont ces séances de situation de travail reconstituées ou stimulées.
L’organisation de situations de travail reconstituées ou simulées (STRS) peuvent emprunter différents formats : dispositif de simulation ou de réalité virtuelle, atelier de production, conduite de projet (individuel et/ou collectif) adossé à des cas pratiques, jeux de rôles. Appréciées par les apprenants, ces STRS les confrontent, dans des conditions aménagées à des fins didactiques (droit à l’erreur et au tâtonnement, guidance par les formateurs), à des
situations qu’ils rencontreront chez leur employeur.
Elles constituent un espace préparatoire aux périodes en entreprise en proposant aux jeunes un lieu (à distance des impératifs productifs) pour s’entraîner aux activités emblématiques du métier visé, en comprendre les tenants et les aboutissants, et identifier les savoirs utiles à mobiliser pour les effectuer.
♦ Les investigations ont pointé 4 configurations susceptibles d’amoindrir le potentiel formateur des STRS :
– Ces situations risquent de générer chez les apprenants le sentiment d’être dépassés et, in fine, d’alimenter des formes de désengagement lorsqu’elles affichent un niveau de complexité trop élevé en raison d’un nombre d’incidents introduits à un rythme soutenu et inadapté.
– Les apprenants expriment de l’insatisfaction si les formateurs en charge d’encadrer les STRS parce que peu disponibles et/ou se contentant de fournir des explications sur la dimension opératoire liée à la réalisation du geste, et sans s’attarder sur les opérations mentales sous-jacentes à l’action ou les connaissances théoriques et savoirs disciplinaires utiles à convoquer. Il s’agit de « comprendre et penser ce qu’on fait ».
– L’absence d’acteurs compétents pour faire exister et animer ce type de formation et maitriser à la fois le contenu des cours et les pratiques professionnelles. Or, cette double expertise n’est pas toujours présente au sein des équipes pédagogiques.
– Enfin, les contraintes organisationnelles risquent de prendre le pas sur des considérations relatives à la cohérence pédagogique.
♦ Les apprenants portent un jugement globalement positif si :
– Les temps consacrés à analyser leur vécu professionnel offrent aux apprenants l’opportunité de partager avec leurs pairs les tâches qu’ils ont effectuées, les situations qu’ils ont affrontées, les erreurs ou maladresses qu’ils ont commises, les ressources qu’ils ont activées pour dépasser certaines difficultés. Ils peuvent alors découvrir d’autres modèles de structure, de technologie et d’organisation du travail, au-delà de leur propre contexte spécifique. Cet élargissement est d’autant plus crucial que les jeunes tendent spontanément à considérer que les réalités professionnelles singulières qu’ils fréquentent sont représentatives de l’ensemble des configurations de travail.
– Ces moments de prise de hauteur sont l’occasion de rendre intelligibles les écarts entre les situations de travail réelles et les connaissances techniques et scientifiques transmises au centre de formation.
– Enfin, si ce temps AARST a le mérite d’augmenter et de consolider les apprentissages, d’une part en invitant à revenir sur certains évènements survenus dans l’entreprise et que les apprenants indiquent ne pas être parvenus à décoder dans l’instant ; d’autre part en aidant les apprenants à tisser des liens avec les enseignements disciplinaires et à identifier les notions qu’il aurait été judicieux de mobiliser pour effectuer les tâches qui leur étaient demandées.
L’enjeu est de faire en sorte que les jeunes amplifient, complètent et prolongent l’expérience en entreprise, et franchissent ainsi un seuil supplémentaire dans la conceptualisation de l’action, une brique indispensable pour développer des compétences transversales.
♦ Pour surmonter certaines difficultés, il peut être opportun prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos quand ils sont chez leur employeur pour garder une trace matérielle des situations auxquelles ils ont été exposés et les mobiliser pendant les temps de débriefing, permettant d’accompagner les jeunes sur la verbalisation des situations rencontrées. De plus, il peut être utile que les enseignants échangent de manière régulière avec les maîtres d’apprentissage pour connaître précisément ces situations et la manière dont elles se sont déroulées.
Pour en savoir davantage : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2025/05/Note-detudes_N%C2%B013_Alternance.pdf