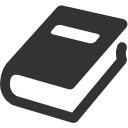Alors que 65% des Français disent vouloir acheter Français, le made in France n’occupe que la 4éme place dans l’acte d’achat (23%).
♦ Alors que 65% des Français disent vouloir acheter Français, et que cela est perçu par 75% des Français comme une réponse concrète pour préserver les emplois locaux, soutenir l’économie nationale, et répondre à des préoccupations environnementales, le made in France n’occupe que la 4éme place dans l’acte d’achat (23%).
Et ce malgré les Initiatives privées et publiques valorisant l’origine française des produits, telles : la dernière édition (novembre 2024) du salon du « made in France », créé en 2012, qui a regroupé 1 000 exposants et attiré 110 000 visiteurs ou encore le « parcours des savoir-faire français » organisé par l’État à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en octobre 2024 et la 4e édition de la « grande exposition du fabriqué en France » avec 112 produits français, sélectionnés parmi 2 452 produits candidats à l’Elysées.
Ce motif d’achat arrive loin derrière le prix (80%), la qualité (73%) et la durée de vie (41%).
♦ Le fabriqué en France est toutefois une notion complexe à appréhender.
Le respect des règles ne signifie pas que le produit est 100% Français (c’est-à-dire qu’il a été fabriqué en France uniquement avec des matières françaises). En matière non alimentaire, l’utilisation des couleurs du drapeau français n’est pas interdite, alors que son utilisation peut être en revanche considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
Comme le reconnaît la DGDDI : « La réglementation sur l’origine non préférentielle peut effectivement sembler complexe à un opérateur économique », en particulier pour les PME et TPE. Les règles européennes couvrent 900 pages du Journal officiel de l’Union européenne.
♦ Le doute des consommateurs : 35% des consommateurs déclarent ne pas être convaincus que les produits sont vraiment fabriqués en France ; 45% déplorent le manque de visibilité des produits français. Les 92 labels et certifications publics et privés entretiennent une grande confusion chez les consommateurs.
Par ailleurs, la révolution du e-commerce (8,4Md€ en 2005 de chiffre d’affaires mais 175Md€ en 2025) a élargi la brèche avec un flux ininterrompu de contrefaçons proposées sur les réseaux sociaux et places de marchés. En 2024, 21,5 millions de produits contrefaits ont été saisis, soit 4 fois plus en 5 ans.
♦ La commande publique n’est pas à la hauteur : avec un volume de près de 170Md€, pour plus de 243 000 contrats passés, la commande publique occupe une place essentielle dans l’économie nationale (8% du PIB). Sur le site de l’UGAP, la part de produits d’origine française ne représente que 1% des références proposées aux acheteurs publics.
Les handicaps de l’achat français dans la commande publique sont nombreux :
– La préférence locale n’est pas admise par l’Union européenne,
– La mesure de la part importée dans notre commande publique est totalement déficiente,
– La commande publique est éclatée entre 60 centrales d’achats publics (dont la plus importante est l’UGAP avec un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie),
– Le point faible de la commande publique est l’inexistence des contrôles des engagements des attributaires de marchés publics, notamment en matière environnementale et sociale au niveau national.
Pour en savoir davantage : https://www.senat.fr/rap/r24-754/r24-754.html